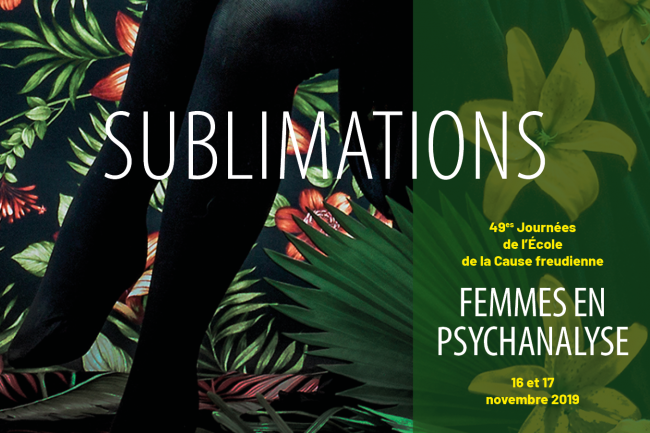
La belle Coré, jeune fille d’une rare beauté, et l’illustration du bonheur et de l’innocence, s’apprête à cueillir un narcisse jaune. Soudain la terre s’ouvre sous ses pieds et le maître chtonien, Hadès, surgit sur son char tiré par de magnifiques chevaux. Il la ravit et en fait sa femme au royaume des Morts. Nous reconnaissons là le mythe du rapt de Perséphone, fille de Déméter, déesse de l’agriculture et de la végétation, et de Zeus. Une illustration ravissante en est donnée dans la grande fresque (340 av. J.-C.) qui orne l’intérieur de la tombe I, dite aussi tombe de Perséphone, à la nécropole des rois macédoniens à Aigéai (Vergina). La fresque représente la scène du rapt telle qu’elle est décrite dans l’hymne homérique à Déméter. Le mythe, forme épique de la structure selon Lacan, habille un réel pulsionnel. Le réel pulsionnel qui sous-tend le mythe c’est la jouissance. Le mythe de Perséphone isole la jouissance féminine quand elle se rapproche de la mort1Laurent D., « Pulsion de mort au féminin », La lettre mensuelle, n° 284, janvier 2010.. La mère de Perséphone, en colère, réclame le retour de sa fille sur Terre. Mais les choses se compliquent car Perséphone tombe amoureuse de son mari. Une version du mythe veut qu’il l’ait liée à lui pour toujours en lui faisant manger des grains de grenade, l’aliment des morts. Elle a consenti finalement à prendre sa place de reine à ses côtés. Assise auprès du trône, sévère et inflexible, elle brandit un flambeau et agit en accord avec son mari. Ravie, Perséphone, devient aussi la reine ravagée, épouse de la Mort. Son nom, Περσεφόνη, dit bien le pillage, la dévastation (πέρθω, πέρσις) et le meurtre (φόνος). Zeus, son père (dont une légende veut que Hadès soit le double), était complice de l’enlèvement. Il sera finalement amené à trouver un compromis entre Déméter et Hadès : Perséphone passera quatre mois aux Enfers (les périodes automnale et hivernale) et huit mois sur Terre auprès de sa mère (le printemps et l’été). Par-delà l’objet oral et sa connexion au cycle de la vie, le mythe de Perséphone situe l’espace d’une jouissance féminine qui unit au-delà de la Loi la Coré (la fille inséparable de sa mère) et la déesse des Enfers, l’aimée de la Mort.
Si les femmes aiment celui qui, mû par son manque-à-être, leur parle, « la thèse de Lacan c’est que la jouissance de la parole, qui est évidemment là dans le signifiant comme tel, est spécialement cette jouissance féminine supplémentaire. C’est exactement la jouissance érotomaniaque, au sens où c’est une jouissance qui nécessite que son objet parle2Miller J.-A., « Un répartitoire sexuel », La Cause freudienne, n° 40, p. 25.». Cet amour au féminin qui se tisse dans la jouissance de la parole se montre dans l’écriture de Rachel Cusk, romancière de langue anglaise. R. Cusk confie qu’après son divorce, dans cette période de grande vulnérabilité affective, quelque chose de nouveau a eu lieu pour elle. Elle se sentait sans défense, sans identité, sans cadre ni lieu. C’est alors qu’elle se mit à l’écoute des histoires de vie que racontaient des inconnus. Cette expérience est mise au travail dans sa trilogie Outline (Disent-ils, dans l’édition française), Transit et Kudos. La narratrice, Faye, parle à la première personne mais garde le silence sur elle-même. Nous apprenons seulement, en passant, que sa vie a été dévastée depuis son divorce et la perte d’amour qu’il représenta pour elle. La critique sensible à cet effacement de soi a fait le rapprochement avec le délaissement propre à la tradition mystique3Offill J., « Rachel Cusk Strips the Novel Down to Its Frame. Again », The New York Times, 6 juin 2018.. La douleur éprouvée de la perte « de la certitude de l’amour partagé4Laurent D., « Phallus ou symptôme ? », posté le 22 mai 2019 sur le blog Midite des J49.» avait laissé l’écrivaine seule, abandonnée à elle-même dans un espace sans attache et sans limite. Elle se dit incapable de mobiliser l’appareil du sens comme auparavant lorsqu’elle construisait les caractères de son roman. Faye, sorte de « elle » aux contours indéfinis, se fait l’interlocutrice des personnages qui lui parlent, chacun à partir d’une perte et plus particulièrement d’un ratage survenu dans sa vie amoureuse. Ce sont des récits éclatés, parfois drôles, mais qui ne forment pas une fiction. R. Cusk puise dans la tradition des tragiques grecs pour mettre en place ses formes d’écriture. Le premier volet de sa trilogie se déroule dans l’Athènes plongée en pleine crise grecque. Les romans de la trilogie se structurent sur le couple que forme la narratrice avec grand A barré. Lorsque « la demande d’amour, dans son caractère potentiellement infini, revient sur le parlêtre féminin sous les espèces du ravage5Miller J.-A., L’os d’une cure, Paris, Navarin, 2018, p. 83.», l’écriture permet, comme ici à cette femme, de fixer la pulsion qui part à la dérive. « Que vaut la parole ? », se demandera donc Elena dans l’un de ces récits. C’est en effet toute la question. Elle sous-tend l’ensemble de la trilogie qui est une méditation sur le dire de la perte et la possibilité de l’écrire.