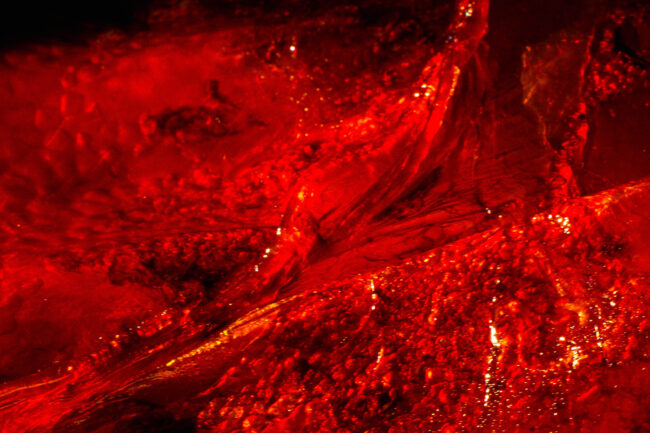
Éclairer l’acte psychanalytique — dont dépend la définition de l’analyste — impose d’en cerner les contours. Or, plus on s’en approche, plus la pensée s’embarrasse et le sens glisse. Lacan interroge alors : « Peut-il y avoir chez moi un autre dessein que de saisir l’acte psychanalytique du dehors ? Oui 1». Et d’ajouter : « C’est bien là le grave de ce discours, que ce n’est point pensée sur l’acte, c’est discours qui s’institue à l’intérieur de l’acte 2». Véritable renversement topologique qui éclaire l’articulation de l’acte et du discours analytique.
Discours du professeur / discours analytique
Nous voilà avertis, le Séminaire XV ne relève pas d’un discours sur l’acte, ce qui tient, énonce Lacan, à la différence « entre [sa] position dans ce discours et celle du professeur 3». Son enseignement n’est pas un cours. Et il précise : « Je ne suis pas professeur parce que, justement, je mets en question le sujet supposé savoir 4». Le professeur s’en garde bien, il en est même le « représentant 5», et depuis cette position externe, livre un savoir sur son objet, une construction « bien reposante, où l’on voit les choses bien rangées 6».
Dire « je ne suis pas professeur » répond à « je suis psychanalyste et dans l’acte psychanalytique je suis moi-même pris 7». Mettre en question le sujet supposé savoir relève du procès même de l’analyse et place le discours qui en répond sur les pas de la logique, qui a pour fin d’exclure « comme tel, le sujet supposé savoir 8».
« La psychanalyse ça fait quelque chose 9»
Ne pas être professeur a des effets. Lacan en est informé, son discours est scabreux, précaire, insatisfaisant, voire horrifiant, jusqu’à la panique10, autant d’indicateurs de ses « effets d’acte 11». Se faire comprendre n’est pas une option, pour qui veut transmettre du nouveau, puisque l’on ne comprend « qu’un sens dont on a déjà éprouvé la satisfaction 12». On ne comprend que ses fantasmes. La vérité, en revanche, « n’est pas quelque chose qui se sait comme ça, sans labeur 13» et y toucher suppose, y compris pour celui qui enseigne, un effet de rupture avec le discours établi. Cette rupture ne va pas jusqu’au « détachement du sujet de tout ce qui peut se passer entre lui et l’Autre 14». Si le discours analytique met en question le sujet supposé savoir, il ne le tient pas pour rien, il le met même en fonction. Lacan interpelle souvent son public parce que l’acte où s’institue son discours, à la différence d’un cours clé en main, ou d’une expérience scientifique, tient compte de l’Autre, est dans la dépendance de l’Autre auquel il s’adresse.
Depuis l’acte
À suivre la logique, qui a pour fin « d’être interne à l’opération elle-même 15», Lacan situe le discours psychanalytique non pas comme discours sur l’acte, ni comme acte lui-même, mais comme discours depuis l’acte, « qui s’institue à l’intérieur de l’acte 16» et s’articule en savoir. Topologie qui rappelle la formule : « le non-su s’ordonne comme cadre du savoir 17» : l’analyste n’opère pas à partir d’un savoir de professeur sur le tableau clinique, mais à partir de ce non-su, cette « naïveté d’un type nouveau 18» qui le fait lui-même pris dans le tableau. Sa position dans le discours psychanalytique n’est pas d’être sujet de la connaissance, mais instrument de révélation d’un savoir qui n’était pas déjà là.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’acte psychanalytique, Paris, Seuil/Le Champ Freudien, 2024, p. 73.
[2] Ibid., p. 183.
[3] Ibid., p. 185.
[4] Ibid., p. 184.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid., p. 73.
[8] Ibid., p. 183.
[9] Ibid, p. 12.
[10] Ibid., p. 185.
[11] Ibid., p. 127.
[12] Miller J.-A., « Microscopie », Ornicar ?, n° 47, 1988, p. 59.
[13] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’acte psychanalytique, op.cit., p. 295.
[14] Ibid., p. 297.
[15] Ibid., p. 183.
[16] Ibid., p. 183.
[17] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 249.
[18] Miller J. A., “Logiques du non savoir en psychanalyse”, La Cause freudienne, n° 75, 2010, p. 174.