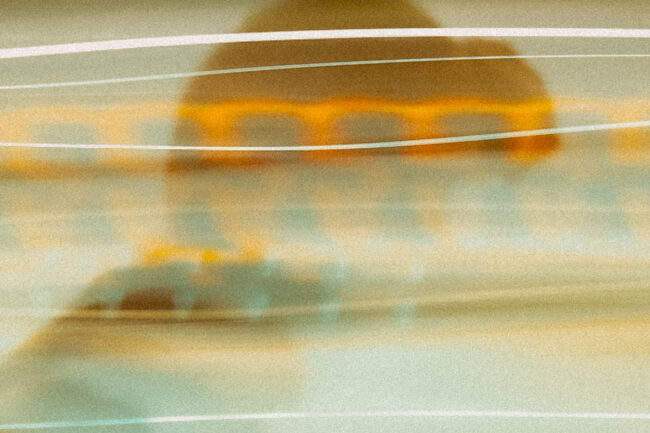
Dans le Séminaire L’Acte psychanalytique, Lacan avance une formule surprenante : « une dimension commune de l’acte est de ne pas comporter dans son instant la présence du sujet 1». Étonnante, surtout si l’on se souvient que, dans le Séminaire précédent, La logique du fantasme, l’acte est défini comme « un signifiant qui se répète 2». Or, si le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant 3, l’acte engagerait donc une forme de représentation du sujet. N’est-ce pas là un paradoxe ? Comment penser un acte sans sujet ? Pour approcher cette question, arrêtons-nous sur cette expression : dans son instant.
Temporalité de l’acte
Là où Saussure concevait un rapport statique entre signifiant et signifié, Lacan introduit une dimension temporelle 4 : le sens ne surgit qu’après-coup. Il en va de même pour le sujet, effet différé du signifiant. De la même façon, il faut du temps pour qu’un acte s’affirme comme tel. Au moment où il advient, il est indifférent au futur : à l’instant où il se produit, il n’y a pas encore ce qui, plus tard, en résultera comme nouvelle présence du sujet 5. La scansion temporelle de l’acte comporte ainsi un instant d’acte, puis un après, qui ne fait surgir un avant que rétroactivement. De ce fait, un avant est toujours imprévisible et c’est sa réécriture que l’acte vise.
Vers une invention subjective
C’est précisément dans une rupture instantanée avec l’Autre que l’acte s’accomplit, en introduisant une faille dans la temporalité subjective. Cette élision temporaire trouve son paradigme dans l’acte suicidaire, que Lacan élève au rang d’acte par excellence. C’est un moment d’auto-annulation du sujet dans l’Autre, d’extraction du langage et de ses équivoques visant non tant la mort que le cœur de l’être, là où réside la jouissance. Relevant du registre symbolique, l’acte rompt pourtant avec la chaîne signifiante : il est de l’Autre, mais, au moment où il se produit, il est sans l’Autre. Héroïque, analytique ou symptomatique, il introduit une rupture et vise le réel — cette zone obscure qui échappe à la symbolisation — permettant la production d’un signifiant inédit. Lacan, en suivant Cantor, avance que l’acte analytique vise à produire du nouveau : « On peut toujours fabriquer un nouveau nombre […] rien que d’une certaine façon d’opérer 6».
Le psychanalyste n’est pas sujet
Comment l’analyste opère-t-il si l’acte suppose l’abolition du sujet ? Il opère à partir de ce lieu vide que Lacan nomme le désêtre — un lieu sans « je pense » et même sans « je » tout court. Lacan va jusqu’à dire : « le psychanalyste dans la psychanalyse n’est pas sujet, et qu’à situer son acte de la topologie idéale de l’objet a, il se déduit que c’est à ne pas penser qu’il opère 7».
Situer son acte de la topologie idéale de l’objet a engage le corps de l’analyste, traversé par la répétition signifiante de l’analysant : ça agit là où quelque chose insiste. On pourrait même dire que ça agit tout seul, sans sujet. Cependant, ce ça agit tout seul ne relève pas de l’action, simple décharge motrice (comme dans les réflexes pavloviens), passive du point de vue du sujet, que Lacan distingue nettement de l’acte, lequel peut se traduire par un refus d’agir. L’acte analytique vise, comme le formule É. Laurent, à faire surgir l’équivoque, non seulement d’un signifiant, mais aussi de l’objet 8 : ce reste, ce vide, où le sujet a été suspendu, ouvrant la possibilité d’un nouveau nouage subjectif.
Ce qui retient particulièrement l’attention dans cette lecture, c’est ce renversement : ce n’est pas le sujet qui fait l’acte,mais c’est l’acte qui, après coup, fait surgir un effet de sujet nouveau. La psychanalyse lacanienne, ainsi, ne se réduit pas à la recherche des traces mnésiques et d’un savoir « déjà écrit » : elle est une pratique d’invention vivante et d’écriture d’un savoir nouveau, dont la voie royale est l’acte psychanalytique.
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien, 2024, p. 67.
[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XIV, La logique du fantasme, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien, 2023, p. 205.
[3] Lacan J., Écrits, Seuil, 1966, p. 819.
[4] Laurent, É., « Sur L’Envers de la biopolitique », Quarto, n. 115-116, juillet 2017, p. 14.
[5] Miller J.-A., « Jacques Lacan : remarques sur son concept de passage à l’acte », Mental, n. 17, avril 2006, p. 25.
[6] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’acte psychanalytique, op. cit., 2024, p. 18.
[7] Lacan, J., « L’acte analytique. Compte rendu du Séminaire 1967-1968 », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 377.
[8] Laurent, É. « Sur L’Envers de la biopolitique », op.cit., p. 17.