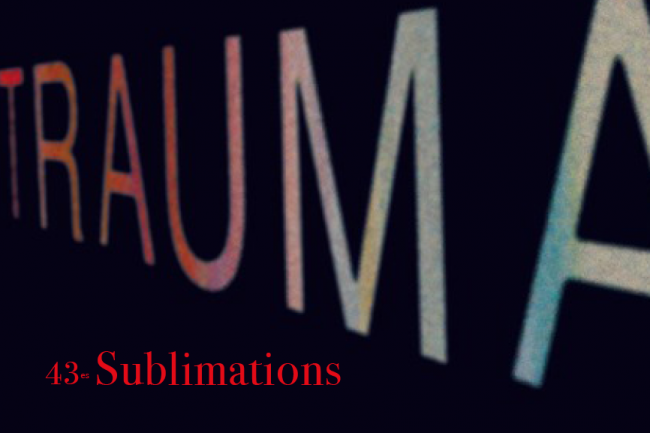
Jean-Pierre Rehm, critique d’art et de cinéma, délégué général du Festival international de cinéma de Marseille (FID Marseille) nous reçoit en plein bouclage du programme de la 24e édition du festival (à partir du 2 juillet 2013).
Propos recueillis par Pamela King et Dominique Pasco.
Rappelons ce lieu-commun : cinéma et psychanalyse sont nés en même temps. Dans cette coïncidence, une complicité autant qu’une nécessité partagées : deux dispositifs ont été mis au point, au même moment de notre histoire, destinés à recueillir et à pointer le trauma. Il y aurait, au cœur de cette faculté d’enregistrement qui caractérise le cinéma, une vocation à toucher au trauma, une affinité, une propension à lui ménager une surface d’accueil. Si le trauma est bien ce qui a laissé une marque indéchiffrable, et que la souffrance qu’il désigne est autant liée à la nature de ce qui a été imprimé qu’à l’illisibilité de cette impression, alors le cinéma, le dispositif cinéma, a trait au trauma. Sur l’écran s’agitent en grand des figures, mais leur trépidation n’est que partiellement motivée par le récit censé les animer. Il y a toujours, ressort plus puissant que le scénario, une énigme, un « secret derrière la porte » (pour reprendre le titre de Lang) : il y a toujours du hors-champ, menaçant, constituant et illisible. Au-delà, donc, de tels ou tels films qui traiteraient explicitement d’expériences traumatiques (les films en vogue à Hollywood, dans les années 1950, qui appuyaient leur scénario sur la psychanalyse, sont peu convaincants de ce côté-là), quelque chose relie structurellement la possibilité du cinéma à l’expérience traumatique.
Un exemple. Berdaguer et Péjus, un couple d’artistes, ont réalisé en 2002 une Traumathèque. De quoi s’agit-il ? Un écran télé, un siège, une K7 VHS vierge à disposition, la glisser dans le magnétoscope et projeter sur elle, « mentalement », l’un de vos traumas. L’opération terminée, inscrire le titre du « film », du « trauma », sur la K7 laissée en consultation. Qu’y a-t-il à voir ? Rien, ou plutôt cette matière vidéo (VHS, les dvd n’offrent plus ce spectacle) faite d’un noir troué de points blancs dansants, nuit neigeuse qui rappelle Citizen Kane ou le Resnais de L’Amour à mort. Spectacle minimal : du noir (projection de la non-projection) est piqueté de points lumineux et mobiles (la naissance de la lumière toujours traumatisée : chorégraphie de la fragilité). Spectacle quasi nul, c’est précisément celui-là que les artistes ont relié au trauma. À son degré zéro, archi-squelettique, le cinéma est donné comme dispositif privilégié d’accueil et d’archivage du trauma, et le décrit comme étant sans image, ou plutôt : comme le clignement de l’image.
Mais le cinéma est ici déjà domestiqué. Si la Traumathèque est destinée à des espaces publics, c’est aussi la privatisation de l’expérience du cinéma, comme celle du trauma, qui est en jeu. Reste qu’avec la salle, le cinéma s’est inventé machine collective. Et que les traumas qui l’occupent relèvent de l’Histoire. Ou, disons, ne cessent d’entremêler l’expérience personnelle avec celle, plus vaste, nationale, extranationale, etc. Les Oiseaux (1963) est à ce titre exemplaire : y sont incarnées à la fois la haine d’une mère pour sa future belle-fille qui se mue aux dimensions d’une plaie tombée du ciel, et la réponse aux attentes du gouvernement américain qui escomptait, en pleine guerre froide, un film illustrant la menace d’une attaque aérienne soviétique. Plus récemment, quelqu’un comme M. Night Shyamalan1Incassable (2000), Signes (2002), Le Village (2004), Phénomènes (2008) multiplie des « pièges à trauma », aussi sophistiqués que celui mis en place dans Fenêtre sur cour (1954). Mais le trauma occupe alors une place au sein d’un régime métaphorique, fantastique.
Plus décisif est de revenir sur l’intuition saisissante de la Traumathèque et de ce que Rithy Panh2Lire aussi l’ouvrage de Rithy Panh et Christophe Bataille, L’Élimination, Paris, Grasset, coll. Littérature Française, 2012. appelle, pour titrer son dernier film, primé à Cannes cette année : L’Image Manquante. Il y est question d’évoquer le génocide au Cambodge sous la domination khmère entre 1975 et 1979. C’est à la fois un récit à la première personne, qui raconte l’histoire de Rithy Panh jeune et de sa famille, et l’histoire d’un peuple, et celle d’un moment de l’histoire mondiale. Mais, en l’absence d’archives, comment procéder ? Au son, la voix raconte sans pouvoir « entrer » dans les images – elle en est, comme dans un univers de limbes, séparée : ailleurs. À l’image, hormis des vues d’époque de Phnom Penh désertée, de modestes figurines de terre arrangent des saynètes quotidiennes. Ce sont les santons d’une Nativité d’un genre inédit : ils veillent sur la naissance d’une Histoire qui tarde, retenue dans les filets du défaut de présentation. Pas de reconstitution historique ici : ces figurines ne se substituent à rien. Littérales, elles sont investies d’une autre charge : donner l’échelle de la miniaturisation qui les a frappées comme par un sort sinistre, faire voir leur mutisme, autre malédiction, et leur immobilité. Pétrifiée, réduite, mutique, c’est désormais le statut de l’image en place de celles qui manquent.