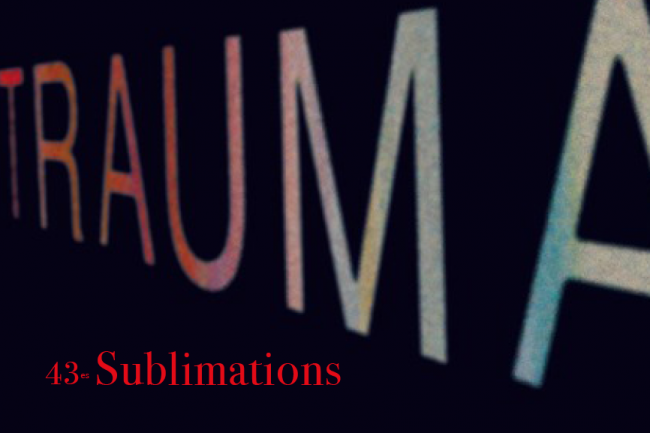
La critique s’accorde pour une très large part à faire du cinéaste Stanley Kubrick un artiste traumatique, au sens positif : insaisissable, laissant toujours quelque chose à penser de l’ordre d’un réel, d’un rebut qui renâcle à se ranger dans le moindre genre. Bref, Kubrick est inclassable : l’ensemble de sa filmographie le démontre.
En effet, de Fears and Desire (1953), son premier film, à Eyes Wide Shut (1999), son dernier – treize films étalés sur près d’un demi-siècle avec deux grands projets qui n’ont pas pu aboutir : un film sur la Shoah et un autre sur Napoléon –, difficile de dégager une quelconque unité, sinon de style et une éthique ferme, sans aucune concession aux « bons sentiments » ; Kubrick, là-dessus, n’a jamais cédé. Chaque film, tiré d’un roman ou d’une nouvelle proposée ou choisie, attaque un genre cinématographique convenu pour en subvertir les codes établis – avec « une virulence du logos » qui atteint son acmé traumatique en quelques moments cruciaux de chacune des trames filmiques : sorte de points de bascule ou de rebroussement topologique, qui nous amènent le plus souvent à une séquence finale équivoque, construite à la façon d’un Witz.
C’est par exemple « le coup de foudre » de Humbert Humbert, professeur distingué de littérature française, pour la jeune et pulpeuse Lolita quand il la voit pour la première fois étendue en bikini dans son jardin en train de lire au soleil ; les quelques paroles échangées (la fille ne manquant pas de bagou) auront alors un impact pour le professeur, allant jusqu’à un meurtre étrange, par lequel d’ailleurs commence le film (Lolita, 1962).
C’est l’utilisation par des primates d’un os comme arme d’intimidation, sorte de prototype du signifiant-maître, qui trouvera dans la suite du film un subtil écho dans les propos inquiétants de l’ordinateur Hall, précurseur du discours de nos modernes psychologues comportementalistes (2001, L’odyssée de l’espace, 1968).
C’est le sauvage passage à l’acte du marine Baleine, lié au discours violent du sergent Hartman qu’il tue en effet avant de se suicider (Full Metal Jacket, 1987). Kubrick nous montre dans ce film sur la guerre du Viêt Nam des marines à la fois traumatiques mais aussi bien traumatisés par un discours militaire déshumanisant, vidé de tous sens de l’honneur, et pris dans une logique médiatique implacable ; la fin du film est à cet égard très surprenante car elle fait surgir un Mickey Mouse à ne pas piquer des vers, ordonnant le pas militaire des soldats américains. L’allusion à Blanche neige et les sept nains est là épatante ! Et puis d’autres moments du film où Kubrick rend en quelque sorte l’ennemi invisible, si bien que les marines semblent poursuivre une ombre d’eux-mêmes, jusqu’à un affrontement singulier avec une femme-soldat… figure tout à coup dévoilée de l’Autre.
C’est l’aveu sensuel et amusé d’Alice Harford d’un de ses fantasmes les plus intimes à son mari William, médecin renommé de Manhattan, qui n’aura de cesse par la suite de chercher une vérité à ces paroles traumatiques, quitte à y perdre la vie, et à échouer dans le monde de la « haute » perversion new yorkaise, où le sacrifice à quelque dieu obscur se pratique : « Ici toute parole donnée ne peut être reprise », dit l’un des personnages masqués à William (Eyes Wide Shut, 1999). La dimension politique du film est à cet égard saisissante, si on ouvre les yeux et les oreilles… Là aussi, la fin reste équivoque, car, après avoir traversé toutes ces aventures traumatiques que nous conte Eyes Wide Shut, Alice formule à son mari (qui lui demande ce qu’il faut faire pour survivre à ces épreuves) : « Il y a une chose urgente qu’il nous reste à faire, c’est de baiser. »
C’est l’ordre insensé d’une hiérarchie militaire perdant les pédales, et menant à la mort de braves soldats dévoués ou toute une population (Paths of the Glory, 1957, Dr. Strange Love, 1964). Dans Les Sentiers de la Gloire, la séquence finale est très voisine de celle de Full Metal Jacket : on y voit en effet une femme allemande chantant pour des poilus très excités qui tout à coup se mettent à fredonner en cœur la chanson populaire allemande, un peu à la façon des fameux sept nains de Snow White ; l’ allusion ici à cette Blanche neige est très bien amenée par Kubrick, et ouvre le film sur autre chose.
C’est le discours froid et déshumanisant de médecins pavloviens voulant dresser le cynique Alex (Orange Mécanique, 1971). Fin du film à la façon aussi d’un Witz où ce Alex (qui semble en effet dressé) triomphe d’une façon plus ou moins étrange de la férule des comportementalistes.
C’est le moment où le sombre et inquiétant écrivain Jack Torrance, postulant pour un poste de gardiennage, apprend par le directeur de l’immense hôtel Overlook – situé dans une zone désertique du Montana et construit sur un cimetière indien – que le précédent gardien, nommé Delbert Grady, a tué sa femme et ses deux filles jumelles avec une hache avant de se suicider en se grillant la cervelle (Shining, 1980). Tout le génie de Kubrick est de nous montrer qu’à partir de là, de ces quelques phrases dites sur un ton plus ou moins diplomatique, Jack Torrance n’aura de cesse, non sans une lutte vaine et acharnée, de prendre la place de ce Grady dont le fantôme, dans une séquence magistrale – à la Shakespeare, à couper le souffle quant à la réalisation et la mise en scène –, lui rétorque (quand Jack le reconnaît) : « Je suis désolé de vous contredire, mais c’est vous le gardien. Vous avez toujours été le gardien. Je le sais, car j’ai toujours été ici. » Point de bascule du film, à partir duquel Jack s’emploiera à pourchasser son fils Danny et sa femme Wendy (qui ne manquera pas de ressources pour protéger son rejeton) avec une hache pour les découper en morceaux. Il y a des séquences tout à fait fondamentales à ce sujet qui ont inspiré bon nombre de cinéastes par la suite : Jack est montré comme « aspiré » par l’hôtel en étant projeté dans un passé lointain, passé lointain qui est matérialisé dans le film par un recul du point de fuite des couloirs de l’Overlook. La fin du film est équivoque, très à la Kubrick, puisqu’elle nous montre, dans le hall de l’hôtel, un Jack souriant sur une photographie « très apaisante », datant de 1921, c’est à dire à une époque où il n’était pas encore né. C’est comme si ce père meurtrier – pour l’enfant Danny – qui est en quelque sorte le point de vue du film (la caméra est souvent à hauteur d’enfant, il y a des travellings remarquables à cet égard où on suit Danny sur son vélo dans un dédale de couloirs où le point de fuite semble se perdre à l’infini) – et qui de façon très ingénieuse échappe à son père en effaçant ses propres traces –, comme si ce père devenait donc un souvenir traumatique. C’est le paradoxe du film, puisque c’est ce qui sauve au bout du compte Danny de la mort : la construction d’un signifiant traumatique.
Cette fin du film, considérée comme l’une des plus secouantes dans l’histoire du cinéma, est en fait le retour de la séquence, très célèbre aussi, d’ouverture du film, qui est un travelling saisissant où la caméra (en surplomb, la caméra semblant voler comme un aigle sur le glacier du Montana) suit une voiture (avec comme fond musical une musique de Berlioz, séquence de La Symphonie fantastique : « le jugement dernier ») qui roule sur une route escarpée et sinueuse, pour finir son chemin à l’Overlook, laissant ainsi derrière elle un étrange sillage. Prologue qui trouve un écho émouvant au moment où le cuisinier de l’hôtel, Dick Halloran, dit à Danny Torrance : « Tu sais quand quelque chose se produit, ça peut laisser un sillage. Comme lorsque quelqu’un laisse brûler un toast. Certains événements passés laissent d’autres sortes de traces. Et pas des traces que n’importe qui peut voir. »
C’est entre le trauma, la trace et son effacement que Shining nous fait voyager, pas sans un effet de Witz, avec son effet de trou, comme la fin du film le montre.