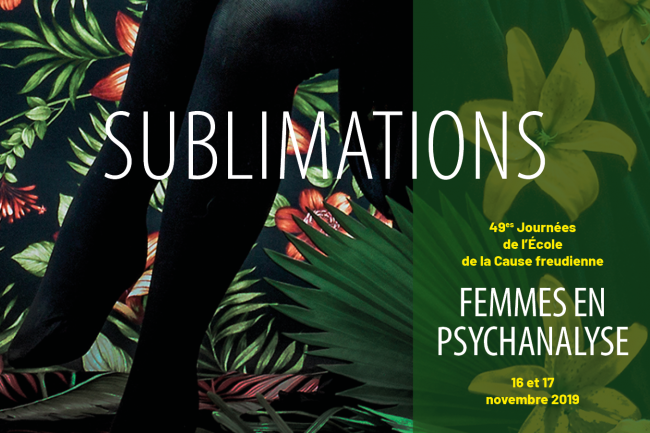
« Rien ne mène – je le sais – à l’amour », dit Colette. « C’est lui qui se jette en travers de votre route. Il la barre à jamais, ou, s’il la quitte, laisse le chemin rompu, effondré.1Colette, La vagabonde, Hachette, Livre de poche, 1990, p. 76.» À quoi Lacan aurait répondu : « À persuader l’Autre qu’il a ce qui peut nous compléter, nous nous assurons de pouvoir continuer à méconnaître ce qui nous manque.2Lacan J., Le Séminaire, livre Xi, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil; coll. Points, p. 150.» Là réside le malentendu amoureux : il promet de nous guérir du manque fondamental, de ce qui nous déchire et ce faisant, il l’agrandit parfois…
Entre liberté indomptable et soumission souveraine, Colette et, avec elle, ses personnages féminins, sont étroitement assujettis à la volupté. Une position féminine se dégage : en quoi ses héroïnes l’incarnent-elles autant qu’elles s’en défendent ?
Délivrée d’un mariage douloureux où elle fut aimante et trompée, Renée incarne la femme libre. Elle est artiste de music-hall, menant une vie de nomade appliquée, à l’âme élégante. Elle offre son corps aux regards mais ne l’abandonne plus jamais aux mains d’un homme. Et voilà que fait irruption dans sa loge un homme, derrière un bouquet, éperdu d’admiration mais surtout – elle le note immédiatement – submergé par le désir qu’il a d’elle. C’est par le sarcasme qu’elle l’accueille, il devient « le grand serin », épinglage qui le dé-virilise, quand c’est justement le trop de virilité qui effarouche la belle Renée. Maxime ne va pas se décourager et poursuivre la dame de ses assiduités, sans faillir. Voilà donc l’épreuve devant laquelle elle recule : consentir à se faire objet du désir d’un homme. Épreuve et tentation, où elle craint de disparaître.
La vagabonde est le récit d’une résistance. Frappée par le désir de Maxime, Renée tente désespérément de se défendre de la séduction exercée par cet impératif du désir masculin. Mais au moment où elle cède, alors tout cède.
« Il n’y a presque plus d’espace, presque plus d’air entre nos deux visages, et je respire brusquement, comme si je me noyais, avec un sursaut pour me dégager. Mais il tient mes mains et resserre son bras autour de ma taille. Je rejette inutilement ma nuque en arrière, au moment où la bouche de Maxime atteint la mienne. […] Oh ! Tout à coup, malgré moi, ma bouche s’est laissé ouvrir, s’est ouverte, aussi irrésistiblement qu’une prune mûre se fend au soleil… De mes lèvres jusqu’à mes flancs, jusqu’à mes genoux, voici que renaît et se propage cette douleur exigeante, ce gonflement de blessure qui veut se rouvrir et s’épancher, – la volupté oubliée…3Colette, La vagabonde, op. cit., p. 186.».
Elle s’abandonne ainsi soudain à la docilité sans limite. Elle envisage même d’effacer sa liberté si précieuse, éprouvant voluptueusement la maxime selon laquelle « passées les bornes, il n’y a plus de limites. » Tentée d’annuler une tournée, elle va finalement imposer une séparation de quelques mois, au moment où elle consent. Ultime pirouette, ultime dérobade. Ce temps passé loin de l’homme aimé lui permet de fuir devant son désir, de le maintenir comme insatisfait. Mais au fond, malgré toutes les bonnes raisons qu’elle se trouve pour justifier sa fuite, Renée n’ignore pas la cause véritable de la défection, dont elle fait l’aveu. Craignant d’être emprisonnée sous le joug du désir d’un homme, elle aperçoit fugitivement que c’est du sien propre qu’elle risquait de se trouver captive.
« Je m’échappe, mais je ne suis pas quitte encore de toi, je le sais. Vagabonde, et libre, je souhaiterai parfois l’ombre de tes murs… Combien de fois vais-je retourner à toi, cher appui où je me repose et me blesse ? Combien de temps vais-je appeler ce que tu pouvais me donner, une longue volupté, suspendue, attisée, renouvelée… la chute ailée, l’évanouissement où les forces renaissent de leur mort même… le bourdonnement musical du sang affolé… l’odeur de santal et d’herbe foulée… Ah tu seras longtemps une des soifs de ma route !4Ibid.»
Fin de la première époque.
On retrouve Renée, dans L’entrave, seule, sur la Côte d’Azur – retirée de sa vie nomade. Un autre homme va s’approcher d’elle, sans crier gare cette fois. Et c’est la soudaineté qui va la désarmer. Elle est prise. Malgré elle. Parce que, contrairement à Maxime, cet homme ne lui laisse pas le choix.
« De ses deux mains libres, Jean m’a saisie solidement par les coudes, de manière que ma nuque a compris tout de suite ce qu’on lui voulait et se ploie en avant – mouvement pour fuir, si l’on veut, mais bien commode pour découvrir la place à baiser… Un bon baiser, chaud, pas trop mordant, long, tranquille, qui prend le temps de se rassasier et qui dispense, après le premier frisson jusqu’aux reins, un contentement un peu léthargique… Un bon baiser immobile, bien donné, bien reçu, sans que chavirent nos corps équilibrés l’un contre l’autre et que je subis les yeux fermés, la bouche close, avec un silencieux soupir de détente : “Ah ! Que je suis bien…”5Colette, L’entrave, Hachette, Livre de poche, 1989, p. 95.»
Et la voilà entravée, empêchée de fuir. Délicieuse entrave dont elle va tenter de se dégager, avant de s’y soumettre, dans un happy end un peu suspect.
Mais tout le roman se concentre dans ce moment où elle consent. Elle est saisie d’un vertige, d’une mollesse, d’un abandon, lié non à une inconsistance mais à ce petit morceau d’infini qui la compose, un point d’impossible à nommer, qui peut l’amener à cette défaillance où elle perd son orgueilleuse stature pour n’être que consentement plus ou moins honteux…
Colette reproche aux hommes de ne pas être à la hauteur de la séduction qu’ils exercent sur ses héroïnes, c’est-à-dire sur elle-même… elle réduit l’homme pour mieux lutter contre sa vénéneuse séduction.
Mais est-ce que ces portraits un peu désobligeants de l’homme, ne sont pas une défense devant ce qu’elle éprouve et qu’elle évoque sans pudeur : le vertige érotique, l’emprise du désir masculin, l’impératif auquel elle ne peut se soustraire, ce point de consentement dans lequel elle bascule et qui l’entraîne vers une part d’elle-même où sa volonté farouche se dissout pour se soumettre à l’homme aimé, ou plutôt désiré ?
Car si c’est la fragilité et la faiblesse des hommes qui sont mises en avant, on aperçoit, à de petites notes transverses, la séduction puissante, la sensualité intense à laquelle elle s’abandonne et qui la déborde. Elle évoque elle-même sa « brulante intrépidité sensuelle6Cf. Colette, Mes apprentissages, Paris, Hachette Littératures, 1936.».
Le désir n’est pas une liberté. Il est une entrave. Une entrave que l’on peut chérir, que l’on peut souhaiter préserver, garder secrète, derrière le front haut, le regard insolent, le verbe impertinent d’une femme émancipée…