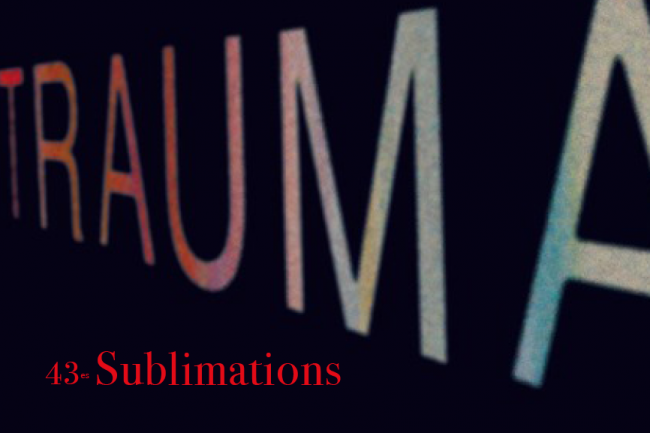
Lydia Vazquez est professeur de littérature française du xviiie siècle à l’université du Pays Basque en Espagne. Elle est traductrice de Marivaux, Crébillon, Diderot, Rousseau, Laclos, Rétif de la Bretonne, Sade…
Auteur de, entre autres, Elogio de la seduccion y el libertinaje, R&B, Alegia, 1998 ; Figuras de mujer (avec Rosa de Diego, Madrid, Alianza editorial, 2003) ; Lumières amères (avec Juan Ibeas, La Rochelle, Himeros, 2007).
Elle s’entretient avec Christiane Alberti, co-directrice des J43.
La philosophie des Lumières ne fait pas de place au trauma. Pour autant, celui-ci est bien présent au siècle de Voltaire. En témoignent les larmes des lectrices de La Nouvelle Héloïse ; elles sont le signe d’un imaginaire littéraire réveillé par le trauma.
Christiane Alberti : L’idée de traumatisme a-t-elle une place dans le classicisme français ?
Lydia Vazquez : La philosophie des lumières se sert d’une idée clé, celle de la gradation. La nature existe, se meut, se reproduit selon ce principe – rien ne se produit par hasard, ni par saut, mais tout advient logiquement et progressivement. Que les choses arrivent graduellement permet de penser l’univers, le monde, l’homme dans son contexte social, comme un continuum où les événements, mais aussi les êtres et les objets, se placent, tels les maillons d’une chaîne, annoncés par celui qui les précède et acquièrent leur sens grâce à celui qui suit.
A l’idée d’une divinité aux origines de la vie se substitue celle d’une matière qui évolue et se transforme pas à pas, par phases, par moments, par tableaux. Le tableau est à cet égard, le pendant spatial du moment temporel, et le réel, tout comme l’imaginaire, sont conçus comme une succession sériée et graduelle de tableaux et de moments consécutifs. En ce sens, il est difficile d’imaginer pour le philosophe du xviiie siècle le concept de trauma, en tant que synonyme de choc, de cassure entre un avant et un après. Ces deux concepts, utilisés souvent dans la peinture de l’époque, servent à loger une image dans une narration qui, autrement, deviendrait instantanée et renverrait donc à l’idée de rupture (je pense ici à Hogarth). Or, cette pensée peut conduire au déterminisme, au fatalisme (« tout est écrit là-haut », dira le Jacques le fataliste de Diderot), à l’optimisme leibnizien (Candide, de Voltaire) ou à son pendant, le pessimisme.
C. A. : En somme, il reviendrait à l’imaginaire littéraire de mettre en scène les ruptures, ou coups de théâtre, ces traumas, que la philosophie semble refuser aux hommes et aux femmes éclairés ?
L. V. : Dans un roman inaugural d’un art nouveau du récit, Les lettres d’une religieuse portugaise, la découverte de la disparition de l’autre – parti vers d’autres contrées transocéaniques, vraisemblablement pour toujours malgré les serments d’amour éternel –, fait sombrer cette religieuse portugaise dans la folie. La cassure du départ, de la supercherie de celui à qui elle a tout sacrifié, provoque un véritable trauma chez la jeune religieuse qui se croyait rédimée d’un destin forcé et injuste, d’un déterminisme implacable, grâce à l’amour. Mais du fait même de ce trauma, la religieuse écrit quelques unes des missives les plus belles de la littérature.
Les lettres persanes sont bâties sur un trauma qui va changer, dès le départ, les personnages puisque l’écriture est là pour témoigner du traumatisme que suppose le contraste des us et coutumes de climats complètement différents. Ce choc traumatisant qui changera la perception de la vie des personnages et entraînera la mort de la favorite du harem, guérit grâce à l’écriture des lettres. Le chevalier des Grieux, et Manon Lescaut : lorsque le personnage de Manon, de qui des Grieux est éperdument épris, meurt. Le trauma du jeune homme sera tel qu’il ne saura faire autre chose que de dire toute son histoire avec sa maîtresse à l’homme de qualité, qui donnera à la confession forme de récit écrit.
C. A. : « L’accident » est donc la variété romanesque du trauma déclencheur d’une nouvelle vie ?
L. V. : La Marianne de Prévost est renversée par un carrosse à l’intérieur duquel se trouve un jeune homme qui va changer sa vie. Le traumatisme de son pied devient métaphore du hasard nécessaire qui donnera sens à sa vie. Et de la même façon, Marianne doit faire le récit de sa vie à son amie, là où le passage à la parole lui permet d’assumer le trauma, la blessure, la fissure. Dans son théâtre, Marivaux se sert du coup de théâtre traditionnel pour le transformer en trauma affectant ses personnages moins légers et comiques qu’on ne saurait croire. Dans La fausse suivante, la découverte finale de l’identité de cette dernière va provoquer un trauma chez les deux autres personnages nobles qui vont voir leurs projets de vie respectifs ainsi bouleversés. La fausse suivante écrira à sa sœur l’histoire de ce qui lui arrive. Dans Les Liaisons dangereuses, c’est la parole écrite elle-même qui fait trauma, puisque c’est la lettre de rupture dictée par Merteuil et adressée par Valmont à Tourvel qui provoque la mort de Valmont et de Tourvel. Dans La Religieuse de Diderot, le trauma se produit par la mise au couvent de Suzanne par ses parents sans son consentement. Une série de traumatismes physiques (sous forme de tortures) et psychiques, et sexuels puisque Suzanne sera victime d’abus traumatisants même si non conscients. Suzanne pourra s’en libérer dès qu’elle écrira son histoire à son bienfaiteur.
C. A. : Le paroxysme de cette thèse sur l’écriture est atteint chez Rousseau et chez Sade ?
L. V. : Oui, au sens où ils font de l’écriture le vide-poches de tous leurs traumas. Jean-Jacques est à l’origine de la mort de sa mère à sa naissance. Élevé dans la douceur féminine et le chant par sa tante, dans la lecture nocturne et compulsive par son père, le départ de cette maison familiale sera une véritable déchirure qui se traduira par une errance d’abord, un isolement ensuite. A cette originalité s’ajoute deux autres traumas : le coup de soleil qui le rend malade et suppose pour lui la révélation d’un devenir écrivain (premier discours, primé) ; le second lorsqu’il décide de quitter ce monde, avec sa montre comme symbole, puisqu’il était genevois et fils d’horloger. Ces deux traumas, l’un involontaire, le deuxième volontaire, mènent Jean-Jacques à la figure de l’écrivain. Chez Sade, c’est plutôt l’écriture qui le mène au trauma, et vice-versa, puisque c’est la radicalité de son écriture qui le condamne à l’enfermement. Cette écriture s’identifie à l’enfermement au point de ne pas être possible sans celui-ci. En somme, au sein d’une philosophie qui nie le trauma, l’écriture véhicule l’imaginaire réveillé, provoqué par le trauma, en se présentant comme salutaire mais en même temps comme moteur du trauma car sans lui, pas d’écriture.
C. A. : Dans cette série évoquée par vous, La Nouvelle Héloïse, véritable best-seller de l’époque, a une place à part, avec notamment l’apparition des larmes.
L. V. : L’idée d’en faire un trauma pour la littérature elle-même me semble géniale et on ne peut plus juste, car ce roman est l’aboutissement d’un processus d’apparition des larmes comme effet de lecture du roman sentimental, qui avait commencé avec Les Lettres portugaises (1669). Le plus ajouté par la Nouvelle Héloïse réside dans ceci que les larmes provoquées par le roman, prennent une ampleur jusqu’alors inconnue, par un effet de contagion. Rousseau était préoccupé de persuader son lecteur que les larmes étaient l’effet de sa sensibilité, celle-ci étant le symptôme d’une âme supérieure. La littérature sentimentale se verra ennoblie et désormais toute la littérature cherchera à émouvoir, à toucher le lecteur bien plus qu’à le persuader. Au fond, on convainc plus par le cœur que par l’esprit.
C.A. : Et la littérature libertine, un trauma pour le lecteur ?
L. V. : Pour ce qui est de la littérature libertine, elle est bien entendu globalement, en tant que production, un trauma pour le lecteur, qui croit toujours à l’amour courtois, à l’amour sublimé, à l’amour tout court (celui que l’on invente) actualisé depuis peu par les précieux du xviie siècle, sanctifié par l’Église, normalisé par les instances politiques, et confirmé par les scientifiques qui invoquent les altérations physiologiques encourues, conduisant jusqu’à la folie ou la mort, dès que l’on pratique un amour (érotisme) non exclusif et ne servant pas la reproduction. Or les libertins, dès le xviie siècle de manière plus élitiste et plus philosophique, et surtout au xviiie siècle, à travers une littérature romanesque destinée à séduire le lecteur (et la lectrice), cherchent à démonter cette idée de l’amour, le parodiant, le subvertissant, le remplaçant par une pratique érotique libre, sans lendemain, sans compromis, c’est-à-dire par un goût que l’on considère naturel face à l’amour, imposition culturelle. La mise en scène de ce goût dans la peinture comme dans la littérature mène droit à la représentation de l’orgasme, masculin mais surtout féminin. Il ne faut pas oublier qu’on vient de découvrir que l’orgasme féminin est sans rapport avec la reproduction et se trouve de ce fait replacé du côté des purs plaisirs, et en tant que tel revendiqué haut et fort par les libertins et les libertines. Mais la simulation de l’orgasme par les femmes va de pair avec cette découverte, et avec la représentation de l’orgasme féminin (d’après un imaginaire masculin, c’est-à-dire rapide et facile) apparaît celle, menaçante pour la virilité des hommes, de la simulation (La Nuit et le moment de Crébillon étant le texte majeur pour illustrer ceci).
C. A. : En quoi l’histoire de l’orgasme à laquelle vous vous êtes intéressée, peut-elle renseigner la conception du trauma sexuel ?
L. V. : Tout rapport sexuel était, pour la femme, un trauma en soi. Élevée dans un couvent, elle ignorait tout du plaisir sexuel, en dehors des caresses lesbiennes à la dérobée, plus ou moins acceptées, plus ou moins conscientes. Dans Les Liaisons dangereuses Laclos dénonce cette éducation déficitaire de la jeune fille au couvent, d’où elle sortait à quinze ans pour être mariée de force avec un homme qu’elle n’avait jamais vu. Cécile Volanges écrit à sa cousine, restée au couvent, lui racontant qu’un monsieur s’est mis à genoux devant elle et qu’elle a cru que c’était son prétendant qui lui déclarait sa passion, comme dans les histoires d’amour courtois qu’on lui avait racontées. Or c’était le cordonnier venu mesurer son pied pour lui fabriquer des chaussures !
De plus, elle était éduquée pour résister à l’homme, pour défendre sa vertu… euphémisme pour parler de la virginité. De sorte que tout accouplement en général, entre une très jeune fille et un inconnu plus âgée qu’elle, ressemble plus à un viol, s’il ne l’est pas de fait, qu’à une partie de plaisir.
Voici comment décrit Joseph II les rapports sexuels de Louis XVI avec Marie-Antoinette, qu’il n’arrivait pas à engrosser : « Dans son lit conjugal, il a des érections fort bien conditionnées, il introduit le membre, reste là sans se remuer deux minutes peut-être, se retire sans jamais décharger, toujours bandant, et souhaite le bonsoir. » Même si le cas de Louis XVI est particulier, le coït marital est loin d’être l’échange sexuel dont peut rêver une adolescente. On ne saurait pas s’étonner du recours féminin à la simulation pour abréger un contact qui n’a rien d’alléchant, s’il n’est pas carrément dégoûtant.
Si la femme retrouve son plaisir, atteint l’orgasme, c’est souvent en dehors du couple. C’est ce dont se vantent les libertins hommes de l’époque. Les héritiers de Dom Juan se disent rédempteurs de femmes « insensibles » qui, une fois qu’elles ont découvert la « volupté », deviennent à leur tour libertines. Mais, à l’encontre des hommes, la libertine doit se cacher pour donner libre cours à sa sexualité, et mène, telle la marquise de Merteuil des Liaison dangereuses, une vraie double vie, ce qui ne va pas l’aider à se libérer de son trauma.
Le xixe siècle, on le sait, n’a pas beaucoup fait pour libérer la femme. Le xxe siècle a assisté à la libération de la femme occidentale et nous nous croyons très loin de ce xviiie siècle moins féministe qu’on ne croit. Et pourtant, combien de femmes hétérosexuelles sont vraiment satisfaites ? Combien ont des échanges libres et épanouis, ne feignent pas, n’ont pas connu de trauma sexuel ?