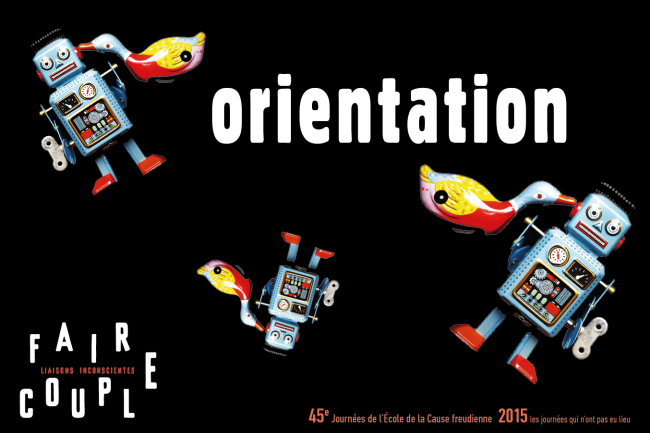
Alexandre Stevens et Dominique Holvoet sont directeurs pédagogiques au Courtil. Ils s’entretiennent avec Virginie Leblanc.
J45 : Quel enseignement sur le couple tirez-vous de votre expérience au Courtil, et peut-on dire qu’il y a une spécificité du couple chez les jeunes en déprise subjective que l’institution belge, orientée par la psychanalyse lacanienne, accueille ? Je pense par exemple à cette expression de Lacan dans le Séminaire iii, à propos de « l’amour mort dans la psychose ».
Alexandre Stevens : Cette question se rencontre depuis les débuts de l’institution. D’abord, avec les adolescents se pose la question du couple puisque notre institution est mixte. Mais j’ai davantage perçu la question du couple comme tel lorsqu’on a créé le centre jeunes adultes, avec ses essais de rapports, les mélange sexe / amour et la difficulté à s’y repérer comme partout mais sans cette stabilité, cette notion de « couple de force » en physique, le truc qui permet de « tenir ensemble ». Par rapport à cette notion « d’amour mort », du côté de la psychose, on pourrait penser que l’amour est problématique faute de dialectique, mais on a dans la littérature de grandes figures d’amoureux, je pense à Nerval, l’amour dans sa dimension idéale… Je n’ai donc pas l’idée que l’amour serait de nature différente dans la psychose, puisque ce qui y domine c’est quand même toujours la dimension de la contingence. Il reste que le rapport transférentiel à l’autre, même si cela dépend des psychoses, est touché par quelque chose de particulier quand c’est l’autre qui sait, et qui sait trop, mais combien de couples de névrosés n’organisent pas une paranoïa interne au bout d’un certain nombre d’années ?! Je n’ai donc pas du tout l’idée que la distinction couple névrotique / couple psychotique soit pertinente aujourd’hui.
Dominique Holvoet : « L’amour mort dans la psychose », cela pourrait apparaître comme une formule choquante et discriminante… Mais est-ce qu’on ne peut pas y voir quelque chose de l’amour nu, au sens où quand l’amour n’apparaît plus dans sa dimension de voile du réel, on a affaire à quelque chose qu’on pourrait alors nommer « l’amour mort » ? Dans l’expérience que j’ai pu connaître avec les résidents, on s’est prêté à accompagner, sans entrer dans la dimension imaginaire de la chose, la constitution de couples de jeunes adultes, et ça a été un appui productif, car y compris dans des institutions comme le Courtil, un sujet peut trouver un partenaire symptôme. Cela peut parfois aller jusqu’au ravage, mais également permettre de trouver sa tempérance, et constituer un duo qui sans doute est un amour mort en cela que chacun est renvoyé à sa solitude fondamentale ; et en même temps, cette fonction de voile de l’amour a pu se rencontrer à l’occasion dans divers couples qui se sont constitués et où manifestement l’un et l’autre trouvaient appui sur son partenaire pour avancer dans l’existence. Ainsi tel jeune schizophrène extrêmement ravagé par sa psychose qui, quand il se regarde dans le miroir, voit une moitié de cadavre. Il se trouve avec une jeune fille qui pratique une sorte de vidage de la langue lorsqu’elle parle, qui fait que ça ne s’arrête jamais, et l’un et l’autre arrivent à faire couple avec cette sorte d’ « appui contre » que constitue l’autre, c’est-à-dire qu’il fait obstacle à une déliquescence du symptôme, quelque chose qui détricoterait le symptôme.
Ainsi, même si le tout dernier enseignement de Lacan remet en cause cette stricte opposition névrose / psychose, on pourrait dire que dans le couple psychotique, les phénomènes apparaissent de manière plus dénudée, on est tout de suite au fait du partenaire comme symptôme, et donc du ravage que cela peut constituer. C’est tellement singulier. Mais ce que j’ai appris ici, c’est que lorsqu’on a de grands préceptes sur ce qui serait bon pour un sujet, on méconnaît la force du lien, celui au partenaire, ou encore à l’enfant, comme dans les cas de ces jeunes filles qui veulent absolument devenir mères : il y a quelque chose que l’institution n’arrête pas. Et une institution telle que la nôtre ne doit pas s’ériger en maître de la sécurité sanitaire. Il s’agit plutôt d’accompagner de la meilleure façon, en étant le plus ouvert à tous les possibles. C’est-à-dire, et c’est la spécificité du Courtil, en analyste. La position de l’analyste n’est pas de choisir pour l’analysant, mais de mesurer ce que l’analysant peut supporter d’un choix. On ne peut choisir à la place de l’autre, bien évidemment, mais il s’agit de mesurer les petits coups de pouce de gauche et de droite pour voir si quelque chose est possible d’un choix. Tout cela est très enseignant d’un point de vue psychanalytique, et l’institution a encore beaucoup à faire pour se tenir à la hauteur de la psychanalyse.
J45 : Chaque groupe de jeunes résidents au Courtil est orienté par un duo, deux « directeurs thérapeutiques » : pourquoi un tel choix du deux ? Ces directeurs font-ils couple à leur manière ?
A. S. : Ce sont effectivement plutôt des duos, encore qu’on parle de couples de danseurs, de chanteurs, professionnels qui agissent dans un certain mouvement pour produire quelque chose. Certains marchent mieux que d’autres d’ailleurs ! L’idée était pragmatique au départ, au moment de la création. Il s’agissait de décompléter de façon simple : la direction de l’ensemble, exercée par Bernard Seynhaeve, et la direction thérapeutique, que j’assurais, était déjà double, donc il semblait logique que ce soit la même chose à l’intérieur de chaque groupe, pour donner également une présence sur le terrain suffisante. Je trouve que c’est important de pouvoir décompléter, trouver la manière à deux de trancher, de décider. L’inconvénient pourrait être qu’alors on ne décide plus. Mais ce n’est pas un inconvénient qu’on a rencontré. Et quand les couples marchent moins bien, ils se répartissent alors la tâche, ou animent les réunions une fois sur deux.
J45 : Pas de risque de routine alors ?
A. S. : Au fil du temps nous avons changé pas mal les couples, ce sont aussi des duos qui changent régulièrement, avec chaque nouveau projet, on défait des couples, on en recrée. La longue habitude a parfois quelque chose de problématique, par exemple, au centre adulte, ils se sont adjoint un troisième directeur ! Mais je pense néanmoins que l’idée importante, c’est que le couple donne une certaine stabilité même si je n’ai pas l’idée d’idéaliser le duo. Il est vrai toutefois que ça fonctionne bien, sans « vieux couple », à cause de la réinvention permanente que nous insufflons dans les équipes.
D. H. : Ce qui est intéressant, c’est que cette forme du deux s’est donnée d’elle-même, ça n’était pas du tout un principe. Le duo, d’abord créé dans le groupe des jeunes adultes si je me souviens bien, a d’emblée bien fonctionné parce que nous sommes très différents, et il y avait un intérêt de chacun à accueillir la différence de l’autre. Pour le dire rapidement, j’étais le pragmatique, Philippe Bouillot le théoricien, il y a donc une dialectique qui s’est installée et ça a fait flores dans les autres groupes. Je pense qu’il y a une tendance, qu’on pourrait appeler la tendance de l’escabeau pour reprendre les derniers développements de Jacques-Alain Miller, celle de se pousser du col et d’y aller tout seul : je pense donc que le duo permet de descendre de son escabeau, et alors de vraiment se mettre à la tâche du symptôme, de voir quel nouage on peut faire avec le symptôme de chacun.
J45 : C’est important ce que vous évoquez car cela va contre l’idée reçue de la complémentarité du duo…
Il s’agit en effet plutôt d’un certain affrontement, mais un affrontement productif, il s’agit d’avoir en face de soi un interlocuteur « valable » en cela qu’il résiste et fait réel si je puis dire. Comme deux symptômes qui jouissent suffisamment de s’affronter pour rester ensemble, et créer du neuf, un bricolage singulier, comme dans le couple amoureux d’ailleurs !