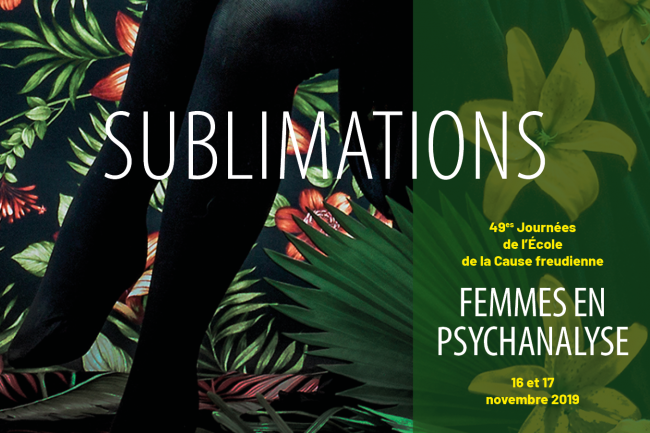
[…] la Mère reste contaminer la femme pour le petit d’homme […]
J. Lacan1Lacan J., « Télévision », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 532.
Cette contamination est un des facteurs du refus de la féminité. La littérature romanesque a souvent magnifié la Mère plutôt que la femme. Le roman d’Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes2Fournier A., Le Grand Meaulnes, Paris, Livre de Poche, 2008, p. 306., est la narration faite par François Seurel de l’adolescence de son ami Augustin Meaulnes. L’adolescence est une aventure qui implique d’inventer une réponse au non-rapport sexuel.
C’est au cours d’une fête marquant le début de cette aventure qu’Augustin Meaulnes rencontre Yvonne de Galais. C’est une fête pour les enfants qui ont le loisir de décider de tout. On y attend Frantz de Galais, frère d’Yvonne, et sa fiancée. Enfant est un signifiant-maître de ce récit. Quand Augustin voit Yvonne pour la première fois, elle joue du piano et des petits enfants l’écoutent. C’est donc une image de mère qui initie cette rencontre. Il s’assoit et des enfants grimpent sur ses genoux. « Alors ce fut un rêve comme son rêve de jadis. Il put imaginer longuement qu’il était dans sa propre maison, marié, un beau soir, et que cet être charmant et inconnu qui jouait du piano, près de lui, c’était sa femme.3Ibid., p. 66.» Lors de la deuxième rencontre, elle coupe court à la conversation où ils font déjà des projets d’avenir : « il faut que je rejoigne les enfants, dit-elle, puisqu’ils sont les maîtres aujourd’hui ». Puisqu’ils sont les maîtres, la mère prend le dessus sur la femme. Mais la fiancée de Frantz ne vient pas et la fête est interrompue. Augustin cherchera à revoir Mademoiselle de Galais, guettant son apparition à la fenêtre d’un appartement parisien. La fenêtre reste vide.
L’image d’Yvonne, possible réponse versant mère à la question qu’est-ce qu’une femme ?, n’obstrue plus le réel et c’est l’occasion d’une nouvelle rencontre avec une jeune femme bien différente, qui dit n’avoir fait que des folies dans sa vie. Quand il apprend qu’elle a été la fiancée de Frantz de Galais, il en conclut qu’elle lui est interdite. Poussé par François Seurel, Meaulnes va retrouver Yvonne de Galais. Leur mariage est de courte durée : une nuit de noces, suivie du départ précipité du Grand Meaulnes qui, à l’aube, fidèle au serment qu’il lui a fait jadis, répond à l’appel de Frantz de Galais. Yvonne l’y encourage, et dira à François Seurel : « Comment celui que nous poussions ainsi par les épaules n’aurait-il pas été saisi d’hésitation, puis de crainte, puis d’épouvante, et n’aurait-il pas cédé à la tentation de fuir !4Ibid., p. 195.» Ici se lit la peur d’une jouissance féminine étrangère, « ombilic du refus du féminin sous toutes ses formes5Cf Monribot P., « Le refus du féminin »», peur attribuée par Yvonne à Augustin, projection de sa propre « épouvante » devant le féminin. Yvonne de Galais va mourir des suites d’un accouchement, et à son retour, Augustin repartira avec sa fille dans les bras. Yvonne de Galais a rempli son office : elle a été mère et peut donc mourir ! Avec elle, c’est l’enfance qui disparaît, ont dit certains commentateurs, mais c’est surtout une femme que le roman n’a destinée qu’à être mère.
Dans la littérature contemporaine, les auteurs vont au-delà. Annie Ernaux, à propos de son livre Mémoire de fille6Ernaux A., Mémoire de fille, Paris, Gallimard, 2018, p. 176., écrit qu’il est une traversée périlleuse jusqu’au port de l’écriture. Ce port n’est pas celui de l’œdipe auquel la petite fille freudienne arrivait. Elle a mis des années pour se décider à entreprendre ce livre. Elle y part à la recherche de la fille qu’elle a été l’année 1958, dévastée par « un événement sexuel singulier dont la honte est insoluble dans la doxa du nouveau monde7Ibid., p. 109.», cette doxa étant celle de la liberté sexuelle. La honte en effet est venue plus tard, l’adolescente qu’elle était ne l’a pas éprouvée, d’où sa recherche ; qui était cette fille, qu’a-t-elle vécu ? Mais écrire sur cette fille est difficile : « les souvenirs sont comme un film dépourvu de signification ». Elle va toujours la nommer « la fille de 58 », marquant là le sentiment d’étrangeté qu’elle lui inspire, sentiment devant lequel elle ne recule pas. Pas de refus ici, mais tentative de donner du sens.
Adolescente éprise de liberté, en véritable collectionneuse, elle s’adonne à une sexualité débridée dans une colonie de vacances où elle travaille cet été-là. Une seule rencontre va compter : celle du moniteur-chef. S’ensuit un véritable ravage : elle est méprisée par lui, diffamée, les insultes pleuvent. Il lui parle de sa fiancée qu’il aime et celle-ci devient l’image idéale à laquelle elle tentera de ressembler. De tout cela elle n’éprouve aucune douleur, son corps lui échappe, rien ne l’affecte. Elle était « évidée d’elle-même » et « seuls les mots mystiques sont à la hauteur de ce que ressent la fille de 588Ibid., p. 79.». Annie Ernaux pourrait être prise à nouveau dans ce ravage : elle se demande si elle écrit ce livre « pour mettre en jeu la figure de l’écrivaine qu’elle est devenue, pour la ravager9Ibid., p. 61.», expérimenter les limites de l’écriture, pousser à bout le colletage avec le réel. Mais cette écriture va lui permettre de « casser le sortilège » qui la retenait depuis plus de cinquante ans. Elle s’interroge aussi sur la boulimie et l’aménorrhée survenues après cette rencontre et qui ont duré deux ans. Elle a le souvenir d’un plaisir du corps devenu un gouffre sans fond. La boulimie a pris le relais du ravage où elle concédait tout, sans limite, les deux étant le mode où se révélait une jouissance Autre. Maintenant, c’est l’écriture qui vient la cerner et Annie Ernaux conclut : « C’est l’absence de sens de ce que l’on vit au moment où on le vit qui multiplie les possibilités d’écriture.10Ibid., p. 165.» L’écriture, ici, a fonction de symptôme, bordant la jouissance sans la démentir.