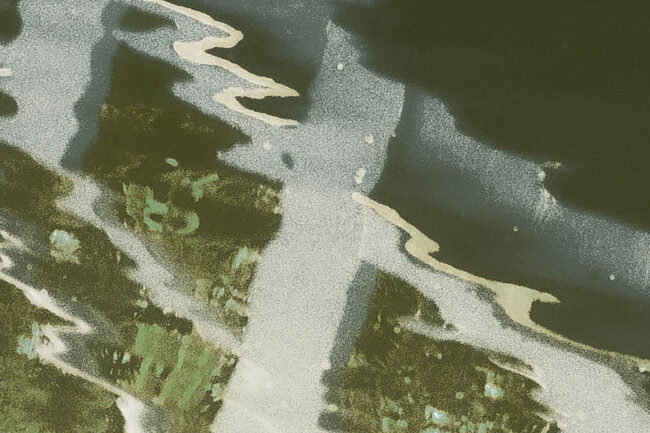
Dans le second chapitre du Séminaire L’acte psychanalytique, on trouve cette phrase : « C’est de là que prend son relief ce dont il s’agit dans l’acte analytique, à savoir le caractère irréductible de l’acte sexuel à toute réalisation véridique. L’acte psychanalytique s’articule en effet à un autre niveau, en raison précisément de la déficience qu’éprouve la vérité de son approche du champ sexuel 1».
Lumineuse et énigmatique, cette phrase, constitue un des nœuds du séminaire : elle condense tout un développement. On la trouve à la fin du chapitre II, intitulé par Jacques-Alain Miller « Connerie de la vérité », titre fort pertinent puisque Lacan y énonce que la dimension propre à la psychanalyse n’est pas tant « la vérité de la connerie », — c’est-à-dire le fait de repérer, dans un ratage quelconque, une vérité cachée qu’il s’agirait de révéler — que « la connerie de la vérité 2». La vérité comme révélation d’un sens ne suffit pas à faire boussole. C’est ce que Lacan met en lumière ici : « partout où la vérité est en prise sur […] notre fonction d’être parlant, elle se trouve mise en difficulté 3», en particulier au sujet du sexuel. Il part de ce constat pour mettre au point l’acte analytique via le transfert et la supposition de savoir, en tenant compte de cet élément hétérogène qui perturbe la vérité elle-même. Lacan va jusqu’à dire que : « le psychanalyste ne prend pas en charge la vérité 4» – ce qui peut paraitre contrintuitif voire révolutionnaire pour les amoureux de la vérité – mais qu’il a à viser « le vide, le trou, la place du désir 5».
Pour faire entendre cette déficience de la vérité à l’égard du sexuel, Lacan fait résonner le terme « déconner », en jouant de l’équivoque du dé privatif : « il dé-connait » : soustraction plus que révélation, il vise la mise en jeu du manque, un (-) plutôt qu’un (+). Pour ce faire, il évoque un exemple d’acte manqué : tirer ses clefs devant une porte qui ne convient pas… Jones en propose diverses interprétations : du j’aurai aimé être ici comme chez moi au j’aurai été mieux chez moi. Lacan précise alors : « autant est pertinente la notation de la fonction du lapsus, du ratage dans l’usage de la clef – soit le réel de l’acte, du ratage à prendre en compte – autant est flottante, équivoque, son interprétation 6».
Lacan poursuit de manière saisissante : si ce que l’acte nous transmet, de manière « pas si conne », est un « point de surgissement, […] un trait de lumière, quelque chose d’inondant 7» – on entend ici la fugacité du trait de réel quand ça surgit : le moment de surprise quand la clef n’entre pas dans la serrure – autant « ce qui essaie de s’y adapter comme qualification interprétative représente déjà une sorte de déconnaissance et de chute 8».
Avec l’acte analytique, Lacan invite donc à remettre au centre de ce qu’il appelle « l’opération vérité », le trou du sexuel, et plus précisément « l’inégalité du sujet à toute subjectivation possible de sa réalité sexuelle 9» – soit une dysharmonie fondamentale, irréductible. Il ajoute : « pour que cette vérité apparaisse, il est exigé que le psychanalyste soit la représentation de ce qui masque, obture, bouche cette vérité, et qui s’appelle l’objet a 10».
[1] Lacan J., Le Séminaire, livre XV, L’Acte psychanalytique, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil/Le Champ freudien éd., 2024, p. 48.
[2] Ibid., p. 47.
[3] Ibid.
[4] Ibid., p. 82
[5] Ibid.
[6] Ibid., p 46.
[7] Ibid.
[8] Ibid.
[9] Ibid., p. 150.
[10] Ibid.