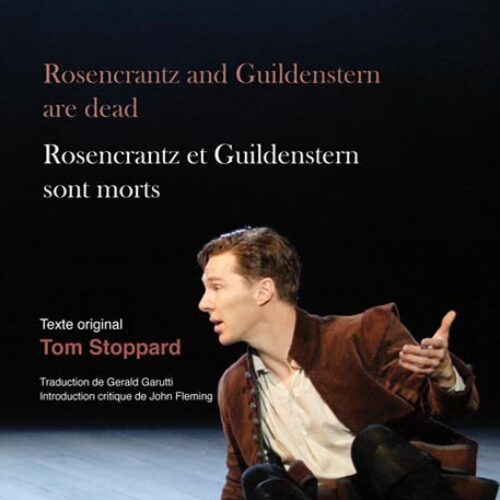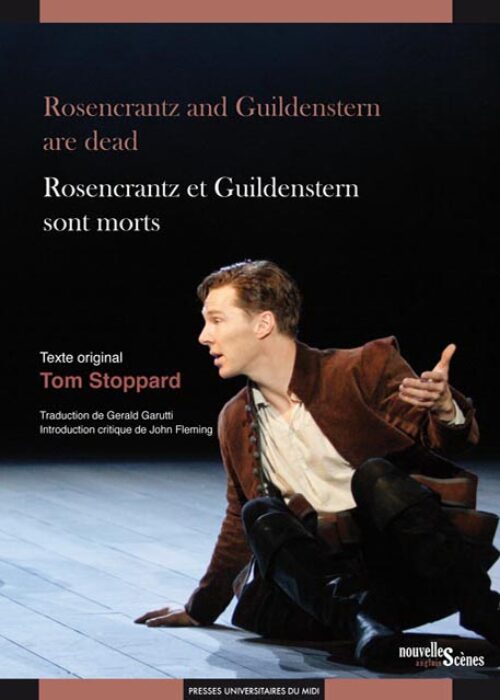-
Lacan ouvre son cours du 6 décembre 1967 avec quelques répliques d’une pièce de théâtre qui connaît alors un franc succès, « une petite pièce fort habile, et même pénétrante, qui m’avait attiré par son titre. Il contient deux personnages […] – Rosencrantz et Guildenstern, l’un et l’autre, nous dit ce titre, sont morts. Plût au ciel que ce fût vrai ! Il n’en est rien. Rosencrantz et Guildenstern sont toujours là.1Lacan J., Le Séminaire, livre xv, L’Acte psychanalytique, Seuil et Le Champ freudien, Paris, 2024, p. 71. »
Cette pièce, écrite par Tom Stoppard, montée à Broadway, avait propulsé son jeune auteur, jusqu’ici rédacteur de feuilletons radiophoniques, au rang de « meilleur dramaturge de langue anglaise » selon le critique du New York Times. Plusieurs fois remaniée, elle connut un tel succès qu’elle fut montée dans vingt-trois pays, en vingt langues différentes. Lacan l’avait-il vue à Paris ? Donnée au théâtre Antoine cet automne-là dans une mise en scène de Claude Régy, elle réunissait entre autres Bernard Fresson en Rosencrantz, Michael Lonsdale en Guildenstern, Jacques Dublin en Hamlet, ainsi que Jean-Pierre Marielle, Tonia Galievsky, Robert Rimbaud, Delphine Seyrig et Claude Piéplu.« Toujours là »
Qui sont ces deux personnages toujours là ? Extraits par Stoppard de la pièce de Shakespeare, ils sont chargés par le Roi Claudius d’escorter Hamlet, qui, depuis la mort de son père, « à l’intérieur comme à l’extérieur […] ne ressemble plus à ce qu’il était2Stoppard T., Rosencrantz et Guildenstern sont morts, Presses Universitaires du Midi, Toulouse, 2023, p. 89. », et doivent transmettre une lettre ordonnant la mise à mort d’Hamlet dès leur arrivée en Angleterre. Hamlet découvre la lettre et la réécrit en intimant l’exécution des deux hommes à sa place. Rosencrantz et Guildenstern apparaissent à l’acte II et à l’acte V, le premier ambassadeur annonce, comme prévu, « Rosencrantz et Guildenstern sont morts3Ibid., p. 259. ». Sitôt mentionnée, leur mort est occultée par celle d’Hamlet, dans le « carnage4Ibid., p. 251. » de la fin de la pièce de Shakespeare.
Stoppard fait des deux comparses des personnages beckettiens, pirandelliens, même sartriens selon les critiques. Propulsés sous les feux de la rampe, ils attendent, discutent, jouent à pile ou face et passent leur temps à essayer de comprendre ce qui leur arrive, à saisir ce qui se passe autour d’eux. L’un philosophe, l’autre le raille. Le « et » qui les relie dans le titre les soude dans la langue au point qu’on les distingue à peine. Les dialogues courent sur l’envers de la tragédie de Shakespeare dans la tonalité de l’absurde. Stoppard, avec ce « nouveau maniement de ces marionnettes essentielles à la tragédie qui est vraiment la nôtre, celle d’Hamlet5Lacan J., op. cit., p. 72. », introduit dans le déjà annoncé, déjà su, de leur mort, un temps d’oubli à l’humour grinçant, d’autodérision ubuesque6Cf. Sokolowski L., l’Argument des J55 Le comique dans la clinique..
Deux coups de force
L’extrait cité par Lacan résonne avec la théorie de la réminiscence du Ménon au chapitre précédent.
Guil lance à Ros : « Dis-moi quelle est la première chose dont tu te souviennes ? – Qu’est-ce que tu veux dire, la première chose qui me vient à l’esprit ? – Non, le premier souvenir que tu aies eu. Longue réflexion – J’ai dû l’oublier. – Justement le premier que tu n’aies pas oublié. Longue réflexion – J’ai oublié la question.7Lacan J., op. cit., p. 71. »Dans le dialogue de Platon, Socrate fait venir un esclave, « un sujet hors classe, un sujet qui ne compte pas8Ibid., p. 60. » pour « démontrer que tout ce qu’elle [l’âme] peut apprendre n’est que ressouvenir9Ibid. ». Car l’âme a « emmagasiné depuis toujours, et d’une façon à proprement parler immémoriale, ce qui l’a formée au point de la rendre capable de savoir10Ibid., p. 61. ». Savoir auquel la réminiscence rouvrirait l’accès.
À partir de ce dialogue, Lacan fait jaillir un élément nouveau car, nous dit-il, il ne s’agit pas tant de savoir « si l’âme existait avant de s’incarner, mais simplement si la dimension du sujet en tant que support du savoir doit être, en quelque sorte, préétablie aux questions sur le savoir11Ibid., p. 62. ». Place aux présupposés, à « ce que j’appelle le sujet supposé savoir12Ibid. » auquel vont s’articuler de façon lumineuse la place de l’interprétation et celle du transfert ouvrant un tout autre accès au savoir.« Le sujet supposé savoir, c’est vraiment un coup de force de Lacan – nous dit Jacques-Alain Miller –, un changement de perspective qui décide de mettre l’accent sur le mode de dit. Il ne dit pas que le transfert est le sujet supposé savoir, il dit que le sujet supposé savoir est le pivot de tous les effets de transfert.13Miller J.-A., « Donc. La logique de la cure », cours du 27 avril 1994. »
Le second coup de force sera de « transférer le transfert […] à une place à laquelle on n’avait pas songé avant lui, c’est-à-dire là où le signifiant est séparé de sa signification14Ibid. ».
Cet effet séparateur ouvrira à une lecture inouïe, bouleversant la perspective de la réminiscence au « dessin jusque-là caché15Lacan J., op. cit., p. 64. » pour faire surgir un nouveau relief car, nous dit Lacan, « le sujet, disons l’analysant, n’est pas ce quelque chose à plat suggéré par l’image du dessin. Il est lui-même à l’intérieur16Ibid. ».À l’intérieur de quoi Rosencrantz et Guildenstern sont-ils pris ? Telle pourrait être la question. Le dialogue sur le souvenir et l’oubli intervient au début de l’acte Un après un jeu de pile ou face qui vide la bourse de Guil et remplit celle de Ros. C’est Guil qui s’adresse à Ros mais leur échange glisse comme une savonnette. Guil constate, désabusé, « je n’ai pas le moindre désir. Pas le moindre. Un messager est passé… c’est ça. On nous a fait venir17Stoppard T., op. cit., p. 53. », puis, il se lance dans un monologue sur la logique qui ne s’extrait pas, sur la loi de la probabilité qui garantirait un ordre à la contingence. L’un et l’autre sont égarés dans ce désert où « le sentiment de la vie fait défaut18Cf. Sokolowski L., op. cit. », dans « ce quelque chose à plat19Lacan J., op. cit., p. 64. ».
La parole prend la forme d’une désarticulation, le comique tenant plus à ce jeu d’habillage de la vanité du savoir que le jeu tantôt revêt tantôt dévêt.La pièce de Stoppard semble se dérouler sans eux, le dessin reste à plat dans l’image :« je me sens comme un spectateur – quelle activité affligeante. […] Quel raffinement dans la persécution – être maintenu dans l’intrigue sans être jamais vraiment éclairé20Stoppard T., op. cit., p. 101. ». Entre leur mort annoncée dans le titre et celle annoncée dans le dernier acte, il y a le déroulement des scènes, il y a le fil qu’ils perdent. Loin du « je perds le fil » dont Lacan rappelle que c’est par là que s’ouvre « le champ du lapsus, de l’achoppement, de l’acte manqué21Lacan J., op. cit., p. 72. », par là que « l’analyse est entrée dans le monde, et y a fait ses premiers pas22Ibid. », ils s’égarent dans le double fond d’un espace fermé par l’ironie, où rien ne sépare du sens, où rien ne se délivre par le sens. Sans aucun sujet supposé savoir pour raviver la langue, l’oubli dans le dialogue du début fait retour à la fin de la pièce : « Ça s’arrête là alors c’est ça ? […] Enfin, personne ne va venir nous traîner hors de scène… […] On n’a blessé personne, pas vrai ? – Je n’arrive pas à me souvenir.23Stoppard T., op. cit., p. 253. » Rosencrantz et Guildenstern quittent la scène, laissant fermé le seuil de l’Autre scène.
- 1Lacan J., Le Séminaire, livre xv, L’Acte psychanalytique, Seuil et Le Champ freudien, Paris, 2024, p. 71.
- 2Stoppard T., Rosencrantz et Guildenstern sont morts, Presses Universitaires du Midi, Toulouse, 2023, p. 89.
- 3Ibid., p. 259.
- 4Ibid., p. 251.
- 5Lacan J., op. cit., p. 72.
- 6Cf. Sokolowski L., l’Argument des J55 Le comique dans la clinique.
- 7Lacan J., op. cit., p. 71.
- 8Ibid., p. 60.
- 9Ibid.
- 10Ibid., p. 61.
- 11Ibid., p. 62.
- 12Ibid.
- 13Miller J.-A., « Donc. La logique de la cure », cours du 27 avril 1994.
- 14Ibid.
- 15Lacan J., op. cit., p. 64.
- 16Ibid.
- 17Stoppard T., op. cit., p. 53.
- 18Cf. Sokolowski L., op. cit.
- 19Lacan J., op. cit., p. 64.
- 20Stoppard T., op. cit., p. 101.
- 21Lacan J., op. cit., p. 72.
- 22Ibid.
- 23Stoppard T., op. cit., p. 253.